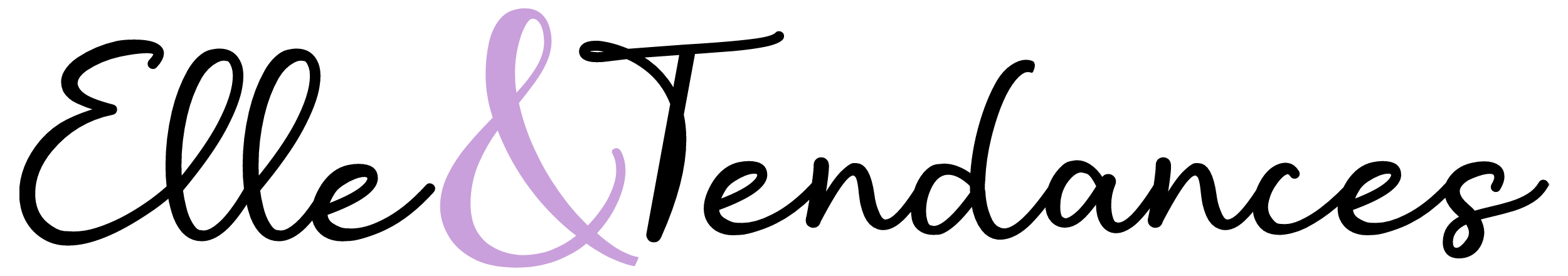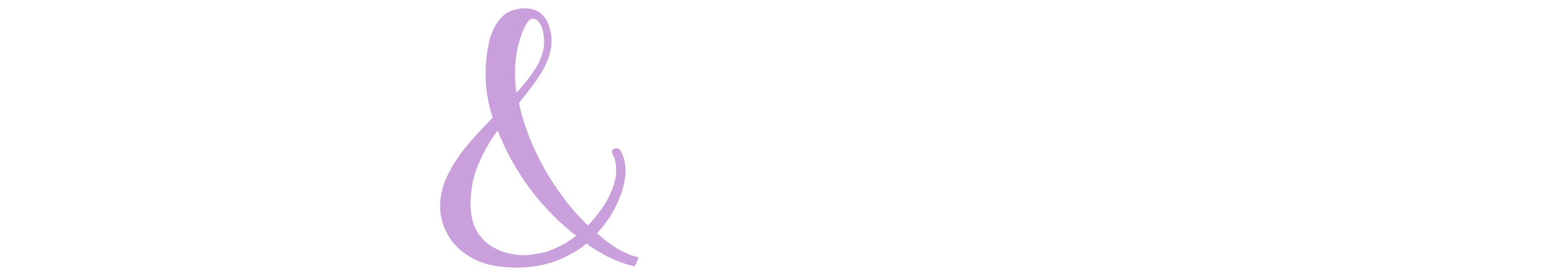Il y a des modes qui nous font sourire, d’autres qui nous intriguent. Le bed rotting fait partie de ces nouvelles habitudes qui enflamment TikTok et Instagram… rester des heures au lit, téléphone à la main, à scroller sans fin ou à simplement « ne rien faire ».
À première vue, l’idée peut sembler séduisante : une pause, un refuge contre le stress quotidien, une bulle où l’on s’accorde enfin le droit de décrocher du monde. Mais derrière ce phénomène en apparence réconfortant se cachent des questions profondes sur notre rapport au temps, à la productivité et au bien-être.
Une tendance née de la fatigue moderne
Si le bed rotting séduit tant, ce n’est pas un hasard. Nos vies contemporaines sont marquées par une course effrénée à la productivité : réunions, deadlines, sollicitations permanentes, sans oublier la pression sociale et familiale. Dans ce contexte, s’enfouir sous la couette apparaît comme une échappatoire presque naturelle.
Pour beaucoup, c’est aussi une manière de dire « stop » à une société qui exige d’être toujours en mouvement. Le lit devient un espace de revendication silencieuse : je ne bouge pas, je ne produis rien, je me laisse aller. Mais cette pause, censée être temporaire, peut vite se transformer en habitude, voire en mode de vie.
Les dangers cachés du bed rotting
Rester allongée plusieurs heures d’affilée, jour après jour, a des conséquences qui vont bien au-delà d’une simple perte de temps.
1. Une relation brouillée avec le sommeil
Le lit est normalement associé au repos réparateur. Or, passer la journée à scroller sous la couette brouille ce signal. Résultat : on dort mal la nuit, on se réveille fatiguée, et l’on entretient un cercle vicieux d’épuisement.
2. Une baisse d’énergie physique
Être immobile de longues heures ralentit la circulation sanguine, favorise les tensions musculaires et coupe l’élan de vitalité. Le corps, conçu pour bouger, se met en mode « veille », et l’énergie devient de plus en plus difficile à retrouver.
3. Un impact psychologique insidieux
Le bed rotting peut donner un faux sentiment de repos. En réalité, scroller des vidéos ou des réseaux sociaux pendant des heures surcharge le cerveau d’informations, souvent inutiles ou anxiogènes. À la clé : une sensation de vide, voire de culpabilité, quand on réalise que la journée s’est écoulée sans rien accomplir de nourrissant.
Pourquoi cette tendance séduit particulièrement les femmes ?
Les femmes jonglent souvent entre vie professionnelle, responsabilités familiales et attentes sociales. Ce poids mental peut être écrasant. Le lit devient alors un refuge accessible et immédiat, un endroit où l’on se déconnecte des injonctions.
Mais attention : s’abandonner régulièrement au bed rotting ne libère pas vraiment du stress, il le masque. C’est comme mettre un pansement sur une blessure profonde sans la soigner.

Repenser le repos : s’autoriser à souffler autrement
La clé n’est pas de diaboliser le bed rotting. Après tout, tout le monde a besoin de moments de flemme, de journées où l’on ne fait rien. Mais il est essentiel de replacer ces instants dans une dynamique plus équilibrée.
1. Redonner au lit son rôle sacré
Essayez de réserver votre lit uniquement au sommeil, à la lecture ou à des moments de tendresse. Si vous sentez l’envie de « décrocher », installez-vous plutôt dans un fauteuil, sur un tapis ou au balcon. Votre cerveau fera ainsi la distinction entre repos et sommeil, et vous retrouverez une meilleure qualité de nuits.
2. Instaurer des rituels de déconnexion
Le soir, avant de dormir, troquez l’écran contre une activité apaisante : écrire quelques lignes dans un journal, écouter une playlist relaxante, pratiquer une courte méditation. Ces petits rituels signalent à votre corps qu’il est temps de ralentir, sans pour autant sombrer dans l’inaction totale.
3. Offrir au corps du mouvement doux
Quand la fatigue est grande, inutile de se lancer dans une séance de sport intense. Une marche de 15 minutes, quelques étirements ou une session de yoga doux suffisent pour réveiller le corps et stimuler la circulation. Le mouvement devient une forme de soin.
4. Se reconnecter au réel
Les réseaux sociaux donnent l’illusion d’être connectée au monde, mais ils peuvent renforcer l’isolement. Essayez de réintroduire des plaisirs simples et concrets : prendre un café avec une amie, cuisiner un plat que vous aimez, jardiner, peindre, ou simplement flâner dans un marché.
Apprendre à écouter ses vrais besoins
Derrière l’envie de rester au lit, il y a souvent un besoin caché : sommeil, repos mental, évasion ou tendresse. Plutôt que de vous juger, posez-vous la question : qu’est-ce que je cherche vraiment en ce moment ?
- Si c’est du sommeil : accordez-vous une vraie sieste réparatrice.
- Si c’est du calme : éteignez vos notifications et plongez dans une lecture apaisante.
- Si c’est de l’évasion : optez pour un film, une sortie, ou un projet créatif.
Cette prise de conscience transforme le bed rotting en un signal, un indicateur que votre corps ou votre esprit réclame autre chose.
Vers une nouvelle définition du self-care
Le bed rotting révèle une chose, nous avons un besoin profond de ralentir. Mais le vrai self-care n’est pas dans l’isolement passif. Il réside dans la capacité à choisir des pauses conscientes et nourrissantes.
Peut-être est-il temps de redéfinir ce que signifie « prendre soin de soi ». Pas en s’éteignant sous les draps, mais en cultivant des moments qui rechargent vraiment :
- Un bain chaud parfumé aux huiles essentielles.
- Une séance de respiration guidée.
- Une promenade en bord de mer ou dans un parc.
- Une activité créative qui reconnecte à soi.
Bref…
On l’appelle le bed rotting. Littéralement « pourrir au lit ». Et si ce choix de mots n’était pas anodin ? Il traduit l’idée qu’à trop s’y abandonner, on risque de laisser « pourrir » nos journées, notre énergie, et parfois même notre moral.
Le bed rotting n’est pas un ennemi en soi. C’est un miroir de notre époque, de nos rythmes effrénés et de nos fatigues silencieuses. Mais il serait dommage de laisser cette tendance définir notre rapport au repos.